
En ce début d’année 2009, la Cour Constitutionnelle du Bénin a rendu une décision qui a fait - et fera… - couler beaucoup d’encre et d’octets : elle a annulé, par DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009, l’élection par l'Assemblée Nationale, le 20 décembre 2008, des 6 députés devant siéger à la Haute Cour de Justice, lesquels provenaient tous des rangs de l'opposition majoritaire - mais non déclarée! - au Président Yayi Boni. La Cour a jugé que cette désignation contrevenait à un principe constitutionnel non écrit : « Le choix des députés appelés à représenter l’Assemblée Nationale en tant que Corps, à animer ses organes de gestion ou à siéger au sein d’autres institutions de l’Etat, doit se faire selon le principe à valeur constitutionnelle de la représentation proportionnelle majorité / minorité ».
Dans un contexte où tant la mouvance présidentielle que le camp adverse usent et abusent de l'instrumentalisation politicienne du droit, la voix du constitutionnaliste sans parti pris se fait peu entendre. Des commentaires très « orientés » s’étalent dans la presse et sur le net, davantage pour blâmer que pour saluer la décision de la Cour Dossou. Vous pouvez en voir un florilège ICI. Vouée aux gémonies par les contempteurs du chef de l’Etat, la Cour Constitutionnelle 2008-2013 aurait, une fois encore, fait preuve de partialité : renversant la jurisprudence antérieure, elle n’aurait pas dit le droit mais aurait servi le pouvoir.
Loin des libelles partisanes, les observations plus pondérées de Serge Prince Agbodjan, parues dans le journal LA CROIX DU BENIN, sous le titre "Décision de la Cour Constitutionnelle: revirement jurisprudentiel au Bénin. La Cour Constitutionnelle de Maître Robert Dossou continue de surprendre!" , offrent une base intéressante à une discussion doctrinale de la DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 . Le raisonnement n’est cependant pas sans faille et appelle certaines objections. Par ailleurs, il convient de mieux faire ressortir les mérites et les défauts du revirement de jurisprudence en cause.
Ce n’est pas toujours la faute à la Cour Constitutionnelle !
Un bon commentateur a une plume acérée, mais il ne se départit pas de la prudence de l’homme de science. Seul un excès de zèle peut expliquer la critique infondée qui suit : « A tout ce qui a été dit, il nous semble urgent d’attirer l’attention de la Haute Juridiction sur un autre élément de la décision du 8 janvier 2009 qui suscite notre inquiétude. Il s’agit de la lenteur observée au niveau de la Cour Constitutionnelle pour exercer ses prérogatives contenues dans l’article 114 de la Constitution. En tant qu’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, comment peut-elle attendre 21 mois après l’installation de l’Assemblée Nationale pour enjoindre cette dernière à élire ses 6 membres de la Haute Cour de Justice surtout que cette Juridiction a instruit un dossier dont l’un des présumés est mis sous mandat de dépôt et attend malheureusement et sans espoir son jugement ? Comment assurer cette mission de gardienne des libertés publiques et des droits de l’homme dans une pareille situation ? Comment expliquer ce silence de 21 mois de la Cour Constitutionnelle alors même que 6 de ses membres sont membres de cette juridiction ? ».
Que l'Assemblée Nationale, en l'absence de tout délai prescrit par la loi organique, n’ait pas fait diligence pour installer la Haute Cour de Justice est assurément regrettable ; qu’Alain Adihou, ancien ministre, incarcéré depuis le 25 octobre 2006 après sa mise en accusation par l'Assemblée Nationale, pour détournement de deniers et biens public dans le dossier LEPI, n’ait pu donc être jugé à ce jour est inadmissible dans un Etat de droit. Seulement, il n’appartenait évidemment pas à la Cour Constitutionnelle de combler d’office, de sa propre autorité, de telles carences. Si, de jurisprudence constante, la Cour considère – non sans audace ! - que sa mission constitutionnelle d’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics l’autorise à régler certains différents, elle n’intervient qu’en cas de contentieux porté devant elle ; autrement dit, elle s’autolimite et, en particulier, elle ne s’immisce dans le déroulement de la vie démocratique qu’à condition d’être régulièrement saisie d’un conflit. En l’espèce, sauf erreur de ma part, nul ne s’est plaint du retard déraisonnable accusé par l'Assemblée Nationale pour élire les 6 députés devant siéger à la Haute Cour de Justice.
Il est pour le moins déplacé d’imputer à la Cour Constitutionnelle une faute qu’elle n’a pas commise.
La Cour Constitutionnelle n’a pas dit que…
Un commentateur avisé tire, avec le recul indispensable, les leçons d’une décision, il n’extrapole pas dans la précipitation. La lecture attentive et raisonnée de la DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 fait douter de la pertinence, voire ruine les assertions suivantes, que partage « l’opposition » : « nous pouvons affirmer selon cette nouvelle jurisprudence du 8 janvier 2009 que l’actuel bureau de l’Assemblée Nationale est contraire à la Constitution dans la mesure où au moment de sa mise en place aucun membre de la minorité parlementaire n’a pu obtenir une place sur les 7. Deux tendances en accord ont pris la totalité des postes privant, de ce fait, la minorité parlementaire d’alors. Et pourtant selon la décision DCC 03-117 du 10 juillet 2003, le juge constitutionnel de 2003 ainsi que celui de 2007 avait dit et jugé que cette élection est conforme à la Constitution.
C’est le cas également du choix par le bureau actuel de l’Assemblée Nationale des 4 membres de la Cour Constitutionnelle où la minorité constituée de 3 sur 4 n’a pu obtenir satisfaction ».
C’est pour solutionner un litige déterminé que la Cour Constitutionnelle, dans la décision critiquée, a dégagé – à tort ou à raison - le principe à valeur constitutionnelle de la représentation proportionnelle majorité / minorité : « ni la Constitution, ni la loi organique sur la Haute Cour de Justice, ni le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale n’ont expressément prévu une procédure spécifique pour cette élection ». En revanche, le principe tombe lorsque le risque de déni de justice n’existe pas, si les textes applicables règlent la conduite à tenir.
S’agissant du bureau de l'Assemblée Nationale, le règlement de l'Assemblée, en son article 15.2-b, dispose que « L’élection des deux Vice-Présidents, des deux Questeurs et des deux Secrétaires parlementaires a lieu, en s’efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée ». Si ce texte est certainement discutable quant à son contenu, il a le mérite d’exister. Et la Cour Constitutionnelle, l’a appliqué à la lettre, dans sa décision DCC 03-117 du 10 juillet 2003 : l'article 15.2-b « ne définit pas la notion de configuration politique à cette étape de l’activité parlementaire et n’impose aucune obligation de résultat » ; « ledit article, tout comme la pratique parlementaire issue de son application, ne donne pas un contenu à la notion de configuration politique en début de la législature, lors de l’élection des membres du Bureau de l'Assemblée Nationale, et n’indique pas comment reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée ». En l’absence de tout réaménagement des règles du jeu par l'Assemblée Nationale, la Cour Constitutionnelle pourrait fort bien reconduire cette solution très respectueuse de l’autonomie parlementaire, nonobstant la DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 .
Le choix par le bureau de l'Assemblée Nationale de 4 des 7 membres de la Cour Constitutionnelle devrait échapper au principe précité pour une raison capitale : l’organe directeur de l’Assemblée – et non la plénière…- ne choisit pas des députés pour représenter le pouvoir législatif à la Cour Constitutionnelle ou pour siéger au sein de la Cour ; il nomme des membres de la Cour Constitutionnelle, dans le respect du profilage imposé par l'article 115 de la Constitution. Les textes n’obligent pas le bureau de l'Assemblée Nationale à procéder à des nominations consensuelles, à la majorité qualifiée. Reste qu’il ne faut pas s’obséder du mode de nomination des juges constitutionnels – il n’existe pas de solution parfaite ! -, et s’abîmer dans de sempiternelles controverses, qui existent partout dans le monde. Il n’existe pas un mode de nomination idéal qui garantisse absolument l’impartialité et la hauteur de vue des juges constitutionnels. En revanche, il importe qu’en pratique soit respecté le précepte énoncé par le Haut Conseil de la République, dans sa décision 15 DC du 16 mars 1993 : « Les membres de la Cour Constitutionnelle doivent être indépendants par rapport aux institutions qui les ont nommées et à tous partis politiques, pour mener à bien la mission qui leur a été confiée ».
En outre, on ne saurait sérieusement envisager que la Cour Constitutionnelle ait ouvert la porte à une contestation tous azimuts et de la composition du bureau de l'Assemblée Nationale fixée en 2007, et de la sienne propre fixée en 2008 et validée par la Cour Ouinsou. Qu’aurait à gagner au juste l'Etat de droit et de démocratie pluraliste dans de tels contentieux, alors que l'affaire de la déposition du président de l'Assemblée Nationale est toujours pendante ?
Pour toutes ces bonnes raisons, il y a lieu de penser que la DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 ne fera pas jurisprudence dans des cas apparemment voisins de l’élection de la « part parlementaire » de la Haute Cour de Justice.
Vous pouvez lire ICI sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE la suite et la fin de cette analyse
Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/
 Le droit ne fait assurément pas, à lui tout seul, l’élection. Il n’empêche que son contenu et/ou son application font l’objet de virulentes polémiques – juridiques ou pseudo-juridiques -, que ce soit avant ou après les élections. Le Cameroun illustre à souhait, depuis quelques semaines, un phénomène récurrent en Afrique.
Le droit ne fait assurément pas, à lui tout seul, l’élection. Il n’empêche que son contenu et/ou son application font l’objet de virulentes polémiques – juridiques ou pseudo-juridiques -, que ce soit avant ou après les élections. Le Cameroun illustre à souhait, depuis quelques semaines, un phénomène récurrent en Afrique. 
/image%2F1438086%2F20180818%2Fob_2d36db_bolle-cotonou-2018.jpg)




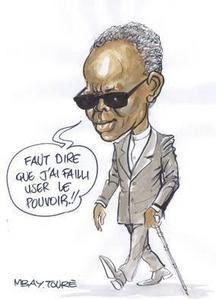









 Pas d’élections crédibles au Bénin en 2011 sans LEPI, sans liste électorale permanente informatisée !
Pas d’élections crédibles au Bénin en 2011 sans LEPI, sans liste électorale permanente informatisée !




